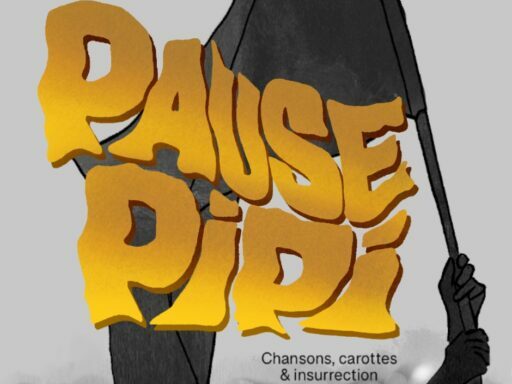Sid aime Cassie. Cassie aime Sid. Elle l’aimera pour toujours et c’est bien ça le problème. Comment affronter l’avenir en acceptant zéro compromission ? Alors Cassie s’en va en courant et débarque à New York où elle est accueillie par Adam qui semble lui aussi en attente sur le bas-côté de sa vie comme une voiture garée en stationnement interdit. L’histoire semble avoir retenu de Skins la mise en scène de la défonce tous azimuts, or la série parle avant tout et à mon sens de sensations fortes dont l’amour sous toutes ses formes fait partie. Semblant sortir d’un transistor mal réglé dans l’appartement d’Adam, “new york, i love you but you’re bringing me down” accompagne l’un de ces flottements mélancoliques dont Skins a le secret.
Pour son oraison funèbre à une certaine idée fantasmée de New York, LCD Soundsystem compose une valse, une danse dont les tournoiements se prêtent merveilleusement aux adieux jusqu’à les projeter sur les hauteurs de Broadway dans un final grandiloquent. “new york, i love you but you’re bringing me down” essaie de faire le deuil d’une ville qui n’a jamais existé et dont les coordonnées ont été établies par son passé musical plus ou moins underground (Velvet Underground, no wave, disco). Tout y passe, de l’explosion des loyers suite à la dérégulation votée en 1994 à la politique menée par Rudolph Giuliani qui se considérait en guerre contre une partie de sa population, à savoir ses administré·e·s les plus pauvres. Dans la grande tradition post-punk, James Murphy la tête pensante de LCD Soundsystem est un peu trop malin pour son propre bien, au risque de tuer dans l’œuf la candeur qui est la plus grande (la seule ?) vertu d’un groupe de rock. Sauf qu’ici le sujet abordé le décentre un peu de lui-même et de ses processus de distanciation jusqu’à ce qu’il baisse la garde. La chanson ne parle pas vraiment de New York, ou plutôt elle aborde la ville sous le regard de Murphy qui a quitté son New Jersey natal pour s’y installer en 1989, attiré par un fantasme alimenté par la pop culture auquel il a lui-même contribué avec LCD Soundsystem jusqu’à son sabordage au sommet lors d’un concert final au Madison Square Garden conclu par la chanson dont il est ici question. Dans un jeu d’équilibriste casse-gueule mais accompli entre sincérité et affectation, l’adieu est aussi poignant que la croyance de Murphy en l’illusion d’une New York bohème vectrice de créativité où chacun·e pourrait se réinventer.
Le Gospel parle très justement de la vente de la ville en tant que marque à haut capital symbolique érigé sur un passé culturel avéré et un marketing éhonté. L’article pose frontalement la question des rôles joués par les musicien·ne·s new-yorkais·e·s dans les processus de gentrification, complices un temps et victimes ensuite du réinvestissement par les classes moyennes des quartiers urbains centraux dégradés et appauvris. En tant que musicien à Bruxelles, une ville jusqu’ici livrée à la promotion immobilière, je suis bien obligé de m’interroger sur mon rôle voire ma responsabilité dans les évolutions que je déplore. En tant qu’expat (avec toutes les caractéristiques et dominations qui y sont attachées), en tant qu’acteur de la gentrification, je contribue à produire de nouveaux types d’espaces où je trouve ma place au milieu de mes semblables en expulsant d’autres habitant·e·s. Tout ça pour finir entouré de bars à jus/frites/cinnamon rolls et tous ces foutus restaurants mono thématiques. Plutôt que de se dédouaner, peut-on faire et habiter la ville autrement ?
Ces temps-ci les dynamiques de gentrification sont particulièrement prégnantes et actives au nord de Bruxelles, la “dernière frontière” symbolique de la capitale. Y est implanté l’immeuble qui abrite la quasi-totalité des locaux de répétition accessibles aux musicien·ne·s et qui fait aujourd’hui l’objet d’une opération immobilière visant à le détruire pour laisser place à des logements “de standing” destinés aux franges les plus fortunées de la population et à la spéculation en général. Difficile de dire si l’attrait nouveau pour le nord de la ville s’appuie sur une appétance pour ses pans industriels et alternatifs vu que ceux-ci sont détruits avant même l’arrivée de nouveaux habitants. A celles et ceux qui clament “et pourtant il faut bien des logements“, on répondra qu’on est bien d’accord avec eux·elles mais que la promotion immobilière ne crée pas de logements pour les populations qui en ont besoin. Aux autres qui se réjouissent de voir disparaître un immeuble dédié à une “activité socioculturelle réservée à une élite bobo de Bruxelles” on rétorquera que l’arbitrage entre les différentes fonctions parfois antagonistes des espaces en ville devrait faire l’objet de décisions collectives et concertées plutôt que d’être laissé au seul marché.
Bien sûr, ce phénomène n’est pas nouveau et ses conséquences sont autrement plus dramatiques pour les classes populaires chassées de leurs logements. Mais dans les arbitrages à mener, il faut non seulement des lieux adaptés aux différentes fonctions urbaines, “mais aussi maintenir les logements à distance raisonnable faute de quoi les nouveaux arrivants se plaignent inévitablement du bruit, et ces plaintes conduisent au départ et à la fermeture des lieux de production.” Dans cet ordre d’idées, on observe et subit également la disparition des bars et autres petits lieux où les groupes peuvent faire leurs premières armes, un mouvement accentué post-Covid où ces endroits peu rentables n’ont pas survécu aux fermetures imposées par les lockdowns successifs. Les micro et nano brasseries ont courageusement pris le relais sans couvrir la totalité des besoins.
Alors que faisons-nous ? A coup sûr, mieux vaut travailler à une mobilisation plutôt que s’avouer vaincu d’emblée. Certain·e·s musicien·ne·s se targuent d’avoir pris les devants en déménageant de leur côté mais à leur place je ne me vanterais pas d’avoir pris une décision individualiste de rat quittant le navire. Si l’individualisme pouvait nous sauver, ça se saurait. Si vous voulez mon avis (pas trop le choix vu que je suis un peu comme chez moi sur Pause Pipi), les pouvoirs publics locaux pourraient reconnaitre l’utilité des fonctions culturelles du bâtiment pour le racheter et en déléguer la gestion immobilière à une association ad hoc. Pour cela, il faudra bien que les musicien·ne·s bruxellois·e·s se structurent collectivement afin de peser sur les décisions en s’appuyant sur les organisations existantes tout en prenant en compte les intérêts des autres populations bruxelloises, à commencer par les plus fragilisées. Il n’y a pas de raison de laisser l’arbitrage aux seul·e·s musicien·ne·s qui ne constituent d’ailleurs pas un groupe homogène même si on aime bien brandir l’étendard communautaire jusqu’au jour où il faut décider de qui doit descendre les poubelles.
Aussi contradictoire que ça puisse paraître, les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle favorisant l’émergence et l’existence des contre-cultures aux marges. Certes, ils occupent actuellement une place non seulement mineure mais aussi néfaste quand ils se font le relais a posteriori des dynamiques impulsées par les acteurs privés marchands. Mais la propriété des murs demeurant une protection efficace contre la revalorisation foncière, ils peuvent contribuer à la lutte contre la gentrification. De notre côté, nous pouvons et devons toujours croire en la mobilisation collective, peser dans les décisions qui concernent les finalités et les moyens pour arbitrer les usages de la ville. Et bien sûr soutenir les travaux critiques de collectifs et d’associations. La guerre n’est pas perdue.