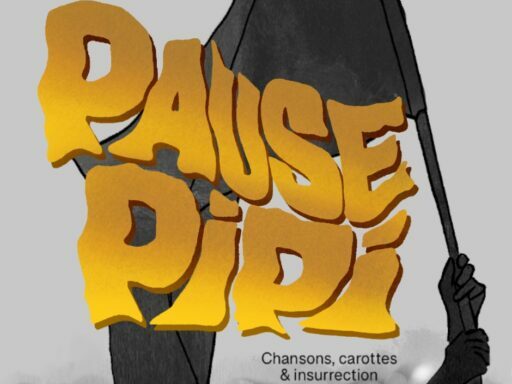Quand le ciel pèse lourd comme ça, on n’a qu’une envie c’est de ralentir le rythme des moteurs, des machines, des musiques. Alors comme chaque année, parce que la météo dicte parfois les choix musicaux, il est temps pour une immersion rituelle dans la musique jamaïcaine. La pesanteur des basses qui plombe encore l’atmosphère âcre de fin d’été, avec cet air chargé aux microparticules qui obstruent les voies respiratoires et les boulevards des grandes villes quand vient la rentrée des classes et des bureaux. De quoi se sentir pousser des ailes mystico-religieuses si on n’était pas allongé en slip sur le matelas, à regarder le plafond. Après tout ça fait quoi, quatre semaines que j’entends (majoritairement) des mecs et (quelques) meufs m’enjoindre à louer Dieu en prévision de la chute de Babylone. A la fin j’y crois presque, même s’il fait bien trop chaud pour travailler à quoique ce soit, fût-ce la fin de l’oppression. Et ce jusqu’à ce qu’elle soit trop bruyante, la voix qui me demande “qu’est-ce qui t’arrive Blanche-Neige, c’est la sueur qui te noie les neurones ? Au point d’oublier que Babylone c’est toi ?“
Il faut croire que les questions n’ont pas vraiment changé depuis le temps où Mick Farren s’interrogeait sur son propre amour pour le reggae de 1976 : “Je ne vois vraiment pas comment un blanc-bec peut vraiment dire quelque chose d’intéressant sur ce genre de reggae au militantisme affiché. (…) Tes origines c’est Babylone, ton éducation c’est Babylone, et toi-même tu es une petite partie de Babylone“. Ces questions agitaient encore Simon Reynolds quelques décennies plus tard dans son article “Racines et avenir – la disparition de la voix dans le reggae”, un papier tellement important qu’il a été publié dans sa traduction française à deux reprises dans des recueils différents. Pour résumer grossièrement : comment puis-je aimer une musique (le reggae et ses ramifications) à ce point éloignée de mon expérience du monde ?
Ce à quoi je me permettrai d’ajouter : comment adresser les contradictions culturelles posées par l’amour des Blancs pour le reggae et ne pas se contenter de le consommer ? Au fond, les critiques musicaux, de Farren à Reynolds en passant par Neil Kulkarni, font dans leurs articles le même reproche à la critique musicale occidentale, celui d’expurger la musique jamaïcaine de ses éléments “problématiques” pour en façonner un ersatz plus facilement appréhendable par la critique et l’auditoire blancs. A une extrémité de ce spectre, on trouve la tendance très située dans les années 70 à valoriser les textes et les chanteurs comme “voix du ghetto” dans la droite ligne du folk contestataire des sixties. L’autre extrême s’est concentré à partir des années 90 sur le dub comme seul domaine réellement digne d’intérêt pour les connaisseurs, en tant que “psychédélisme noir”. Or, si nous sommes bien le siège de conflits qui ne permettent de dessiner que des équilibres temporaires, alors c’est une bonne chose que de garder ouvertes les ambigüités et l’inconfort qui les accompagne. Pour cela, il faut sans doute s’écarter du récit officiel actant la mort de la musique jamaïcaine pertinente en 1982 à la fin de l’ère roots, la faute à la mort de Bob Marley, à l’explosion du trafic de cocaïne sur l’île ou même à la disparition aussi spontanée que soudaine de la créativité dans un genre musical tout entier. C’est d’ailleurs la thèse adoptée par Lloyd Bradley dans son livre Bass Culture où il fustige le reggae post-roots pour son manque d’inventivité à l’avènement du dancehall digital. Il critique aussi sa virilité violente, oubliant que Max Romeo était certes prompt à partir en mission pour détruire le Vatican par le feu (“Fire Fe the Vatican”, ce qui ne semble pas une si mauvaise idée) mais aimait aussi rêver… de chattes (“Wet Dream”).
Qu’il s’agisse du malaise vis-à-vis du machisme régulièrement misogyne et homophobe de ses chanteurs ou du nez pincé face à la religiosité vengeresse des rastas, pas facile d’aimer sereinement le reggae en étant Blanc. “Rien de pire qu’un Anglais portant une casquette de baseball” chantaient les Libertines. Rien de pire qu’un rasta blanc ajouterait-on et personne n’a envie non plus de devenir le “nerd blanc” expert en musiques noires de South Park. Mais la sérénité pointée quelques lignes plus haut, c’est peut-être bien cela qu’il faut éviter à tout prix. D’une certaine façon, la lignée de rude boys repentis du dancehall comme Buju Banton et Capleton ouvre des brèches pour accéder à cette musique sans la dévitaliser pour autant, leurs lyrics demeurant tout à fait cryptiques et leur foi répugnant à l’universalisme. Et tant mieux si tout cela m’est irréductiblement étranger, établissant une conversation sans assimilation (ni dissolution des contradictions). Le baryton étranglé de Banton est ce qu’il y a de plus exaltant de ce côté-ci des enceintes mais quand il chante “there’s no life in the West” je me sens condamné par sa prêche au châtiment divin, tout en me disant que ces accusations rugueuses sont la bande-son idéale pour bouffer de la théorie critique décoloniale.
Dans le goût blanc pour le reggae, il y a peut-être de quoi se coltiner des problématiques très contemporaines, à condition d’accepter de tenir ensemble les éléments disparates, contradictoires et dérangeants qui composent cette musique. Avec ses règles ital pour l’alimentation et son millénarisme très collapso, la foi rasta qui imprègne les musiques jamaïcaines ressemble à une arme puissante dans la confrontation avec nos société post-coloniales et les rôles que nous jouons toutes et tous dedans. Pas de quoi se convertir (remember le rasta blanc), plutôt une manière de garder vivantes les contradictions d’un genre musical issu d’une culture insulaire. La foi rasta et les lyrics aux références locales impénétrables agissent à la fois comme un repoussoir et comme un vecteur du pouvoir de séduction sans cesse renouvelé. Le reggae n’aide pas, il confronte. Il ne pourra jamais m’ “appartenir” comme support d’identification et c’est tout à fait OK. Maintenir la question ouverte impose en retour de ne pas réduire les musiques jamaïcaines à leur contexte social, économique et culturel puisque “l’art doit permettre, entre autres, de s’inventer une autre identité ou une autre réalité“.
Même dans sa frange contemporaine le reggae veut toujours kicker Babylone, la compilation Raggamuffin Power fait voisiner l’egotrip “Sound Killer” de Skarra Mucci et les concours de qui à la plus grosse vertu sur “Roots of All Evil 2.0” avec Million Stylez et Tippa Irie. Le “Dreadlocks Thing” de Brother Culture est quant à lui une manière d’adresser en trois minutes ce que je viens de passer 5.000 signes à déblatérer. Cette musique ne résout pas mes atermoiements de l’auditoire bourgeois blanc, elle brandit bien haut ses contradictions et me les mollarde en pleine figure. Et c’est tant mieux, je l’aurai bien cherché.