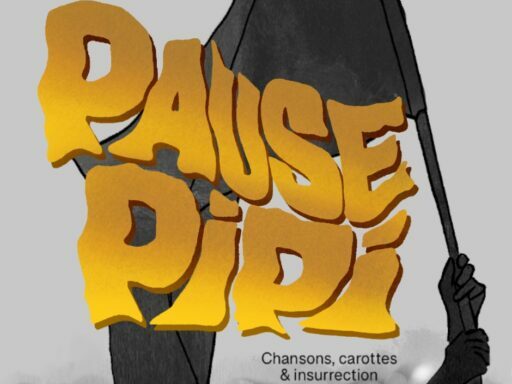Après la sirène de police qui retentit au loin, tous les instruments déboulent sur le beat simple et tout le monde crie “White riot !” Et le gamin avec qui on écoute cette chanson me lance que ça lui donne envie, sans trop savoir pourquoi, de sauter partout ou de se battre. Parce que si à 35 piges “White Riot” me semble une chanson punk par excellence, pour un enfant de 10 ans elle est entièrement et merveilleusement neuve. Là où mes oreilles antédiluviennes entendent un cliché rebattu parce que trop écouté, son cœur à lui bat plus vite que la normale. Et bien sûr, c’est lui qui a raison.
Quand je dis “punk” j’essaie toujours de savoir un peu de quoi je parle mais plus j’essaie moins je parviens à le saisir. En soi, je déteste qu’un groupe “fasse” du punk, “joue” du punk ou même “sois” punk. Le mot recouvre un ensemble de caricatures depuis très longtemps (dès 1978 c’était plié) qui vous décourage voire vous dégoûte de l’employer. Pourtant, si je m’en tiens à la musique, c’est peut-être celle qui m’enthousiasmera toujours sans que je puisse y faire quoique ce soit : des chansons simples jouées sur des guitares à un tempo rapide. C’est insuffisant comme définition mais je n’ai pas trouvé mieux pour décrire ce truc qui, chez moi aussi, accélère instantanément le rythme cardiaque. Ça ne signifie par tout aimer en bloc : même si Crass est un groupe important sur le plan pratico-politique, j’ai du mal à écouter ses disques.
A l’inverse, Grandmas House ne se définit pas comme “punk” per se, les musiciennes du groupe parle d’ailleurs plutôt de post-punk, mais il y a dans leur musique tout ce que le punk a de plus “exhilarating” – pardon pour l’anglicisme mais j’ai l’impression que ce mot véhicule mieux l’ivresse ressentie que ses équivalents français. Des démos enregistrées sur des téléphones dans l’appartement bristolien où elles vivaient ensemble jusqu’à leur deuxième EP Who Am I, les membres de Grandmas House disent avoir beaucoup appris et avec l’apprentissage se précise leur vision quant à la direction dans laquelle elles veulent emmener leur son. Ici jouer fort et gicler de la transpiration partout en prenant des virages à 90 degrés sans même les négocier sur des tempos de polka amphétaminée. Là chanter à trois voix et deux langues sur des harmonies vocales comme un groupe de doo-wop désaxé, de râles gutturaux en pépiements forcenés (“How Does It Feel”). Ce genre de combustions spontanées ne dure pas longtemps, huit minutes pour quatre titres, un peu plus pour leur concert cet été au Micro Festival. Drôle d’endroit d’ailleurs que cette scène liégeoise pour découvrir Grandmas House et ressentir à nouveau le frisson très adolescent du punk rock au milieu d’une foule quarantenaire (estimation basse). Au final, à qui appartient le punk s’il n’est plus l’affaire que d’une poignée d’alternos finissant·e·s, s’il ne sait plus s’adresser à ce qui se meut aujourd’hui ?
Pour en revenir au début de cet article, à partir du moment où le punk ne désigne pas une musique, peut-être qu’il parle de quelque chose qui est un peu plus que de la musique justement. Si le mot punk désigne finalement une longue histoire de musiques contestataires et de pratiques contre-culturelles qui a commencé avant 1976 et continue encore aujourd’hui, alors ce mot abhorré recouvre quelque chose d’à la fois transcendant (une “grande idée”) et très terre-à-terre (un ensemble de pratiques). Je me dis parfois que Dieu c’est comme le punk (mettre les anars en PLS c’est mon métier) : quand je m’en fais ma propre idée je trouve ça séduisant et puis quand j’écoute des gens en parler je n’ai plus aucune envie de m’y aventurer. La faute à l’église dans les deux cas. Pour sortir d’une telle impasse il faut, très justement, des passeurs et des passeuses. Dans son article “Sur les pratiques du punk radical” paru chez Audimat et lundimatin, Alex Ratcharge dresse des généalogies entre les optimismes libertaires sixties, le punk radical et les souhaits prophétiques (espérons) de Mark Fisher concernant l’acidcommunisme. Ce faisant, il permet à des gens comme moi d’accéder à un historique de luttes qui tiennent ensemble leurs pans culturels et sociaux. Et en insistant sur l’horizontalité et la pluralité du punk radical, il rappelle que tout le monde peut y tenir une (voire plusieurs) place. Si la musique ne me parle pas toujours, les aspects que Ratcharge aborde rencontrent un écho particulier dans mes préoccupations quotidiennes dans le travail social communautaire et mon boulot dans la “sociologie punk” (comme on l’appelle entre nous) où on soutient les intuitions critiques et les pratiques des acteurs qui préfigurent d’autres organisations du monde. Le punk radical se coltine les questions du collectif ou de la nécessité de lieux et d’espaces matériels pour espérer faire quoique ce soit, et ce d’une manière totalement revigorante.
Peut-être qu’à la fin, “le punk” revient à cela : ouvrir des espaces. Quand il s’agit d’aller vite, de composer et de monter sur scène dans la foulée, le punk est encore un des meilleurs véhicules et des groupes comme Grandmas House l’utilisent pour prendre leur place et crier leur(s) désir(s). Même si c’est là encore un (demi) cliché, je crois que la candeur est sans doute la seule vertu d’un groupe de rock. Et c’est bien ce genre de naïveté qui maintient la croyance qu’avec l’arsenal du punk pris dans son entier, on peut réaliser des choses. Mais pas trop quand même, chercher Dieu c’est un taf à temps plein et on m’a dit qu’il valait mieux ne jamais travailler.