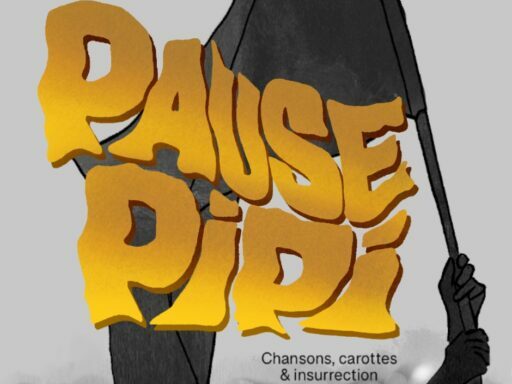Quand Sophie décide d’envoyer à Pierrot un colis rempli de billets de banque, elle le fait “pour la cause” en signant “Ann Bonny”, du nom de la célèbre pirate. Elle réveille alors chez Pierrot, vieil anar non repenti et un des héros grabataires de la BD Les Vieux Fourneaux, le fantôme de ses amours passées. Si les pirates n’ont plus la cote à Hollywood en dehors de la franchise cash machine de Johnny Depp, ils pourvoient toujours un imaginaire puissant pour les marges du “système” qui peuplent entre autres la bande dessinée de Lupano et Cauuet. Il y a vingt ans, Disney tentait une nouvelle adaptation du plus célèbre récit mettant en scène la piraterie, L’Île au Trésor de Robert-Louis Stevenson, en la transposant dans l’espace le temps de La Planète au Trésor. (Non) spoiler : le film fut un four retentissant, un an à peine avant le succès de Pirates des Caraïbes lui aussi produit par Disney.
La Planète au Trésor n’est pas le premier essai de la firme aux grandes oreilles qui avait déjà donné sa version, plutôt fidèle, du roman de Stevenson dans un film en prises de vue réelles datant de 1950 et réalisé par Byron Haskin. L’idée de La Planète au Trésor est mise sur la table dès 1985 par Ron Clements et John Musker, apparemment sans rapport avec le film d’animation bulgare Treasure Planet déjà sorti en 1982 (on en apprend des choses sur l’Internet). La direction des studios Disney de l’époque se montre peu intéressée et refuse à plusieurs reprises la mise en chantier du projet. Après leurs succès publics et critiques éclatants (La Petite Sirène, Aladdin) et avec le soutien de Roy Edward Disney, neveu de Walt siégeant au comité de direction de l’entreprise (dans un contexte de guerre larvée très bien expliqué par le Ciné-club de M. Bobine), les deux hommes reviennent à la charge et obtiennent le feu vert pour leur space opera animé. Le film est développé à un moment bien particulier d’innovation technologique qui rebat les cartes de la concurrence entre acteurs du secteur de l’animation. Le développement des longs-métrages en 3D permet l’avènement de Pixar et Dreamworks (entre autres) comme studios potentiellement ou actuellement concurrents à Disney. Afin de faire face à une possible fuite des talents vers les nouveaux acteurs du marché, Disney consent à revoir à la hausse les salaires de ses travailleur·se·s, augmentant alors les coûts de production de ses films 2D déjà chers à monter par rapport aux long-métrages 3D. Cette inflation des coûts se trouve décuplée par le choix de la firme de dépenser des fortunes en marketing pour chaque sortie de ses produits. En 2003, son directeur Michael Eisner fermera une partie des studios d’animation 2D de Disney pour miser entièrement sur la 3D.

Pur produit de ses conditions de production (voir pour plus de détails la vidéo que la chaîne Écran Large a consacrée au film) tout en étant un vrai projet de cœur de ses réalisateurs, La Planète au Trésor ménage un jeu d’équilibriste qui se révèle payant au milieu de ces bouleversements. D’un point de vue technique, le film ne cède pas au tout-3D qui s’apprête à engloutir l’esthétique des longs-métrages animés Disney mais repose sur un savant mélange entre les deux types d’animation. Avec le procédé Deep Canvas déjà expérimenté sur Tarzan, l’équipe crée un environnement 3D sur ordinateur qui permet une liberté de mouvement totale pour la caméra inspirée par les travaux de James Cameron et Steven Spielberg. L’animation traditionnelle 2D est ensuite intégrée à cet environnement en bénéficiant d’une profondeur de champ où la caméra s’affranchit des contraintes pour se mouvoir. La Planète au Trésor construit ainsi un pont entre deux époques techniques distinctes plutôt que de les mettre en concurrence, au profit de morceaux de bravoure comme la scène de la tempête cosmique. Tout comme Star Wars repose sur des structures de récit déjà éprouvées, le film de Disney s’articule autour du squelette narratif solide du roman initial, permettant ses expérimentations esthétiques. Ron Clements fait le choix, cohérent avec l’hybridation technique précédemment évoquée, d’ancrer l’action dans une imagerie steampunk rétrofuturiste qui fait elle-même le lien entre plusieurs époques : d’une part, les récits positivistes du 19e siècle marqués par les débuts de l’industrialisation auxquels elle pique ses costumes et ses avancées technologiques qu’elle pousse dans leurs extrémités, d’autre part l’anticipation cyberpunk des années 80 marquée par le tout-technologique et les relents de contre-culture. Ici encore, La Planète au Trésor construit des ponts entre les époques, Clements ayant donné pour consigne d’élaborer un design 70% traditionnel – 30% science-fiction faisant le grand écart entre passé actualisé et grand bond vers le futur fanstasmé.
Coup double pour le long-métrage Disney. D’un côté, le roman de Stevenson fournit une assise solide pour tester des choses visuellement ambitieuses, tant dans les techniques employées que dans l’esthétique globale déployée. De l’autre, projeter l’aventure de la chasse au trésor dans le cosmos recoupe une des thématiques explorées par les récits de piraterie : la marge illégale comme espace de liberté à la fois physique et psychologique. En plus de constituer une contre-société avec ses règles propres, telles que la “tache noire” remise à plusieurs reprises à des protagonistes de L’Île au Trésor, les pirates incarnent des formes de refus des normes sociales (notamment en ce qui concerne la propriété privée évidemment). Ce refus est incarné dans La Planète au Trésor comme dans le roman par le personnage de John Silver fuyant la prison et sa mise en cage, aidé alors par le héros Jim Hawkins qui fait office d’alter-ego pour le jeune lectorat – auditoire. Pour vivre cette envie de liberté, La Planète au Trésor offre l’immensité galactique en lieu et place des océans comme terrain de jeu, une extension du domaine de la piraterie. Ces choix d’adaptation radicaux sont ainsi, pour la plupart, non seulement au diapason mais au service de la relecture de L’Île au Trésor. Il y a cependant un point divergent fondamental avec le récit originel qui charge La Planète au Trésor d’une signification particulière. Des points de divergence plus ou moins importants existent çà et là évidemment, par exemple l’absence de consommation de rhum qui, si elle signe l’arrêt de mort du second M. Arrow, est aussi là pour rappeler la dureté des conditions d’existence des marins. De même, la bataille du fortin présente dans le roman et le film de 1950 disparaît, ce moment d’explosion de violence passe à la trappe comme pour lisser voire évincer les conflictualités traitées par l’histoire.
Mais c’est surtout le choix de faire de Jim Hawkins un adolescent indiscipliné plutôt qu’un enfant qui change le sens du récit. L’Île au Trésor est écrit à hauteur d’enfant (soit le lectorat visé) et Jim est un enfant qui se trouve confronté successivement à plusieurs (contre)modèles faisant office de figures parentales : sa mère aubergiste qui l’élève seule après la mort de son père, le docteur Livesey qui incarne l’ordre et la rationalité (qui sont de mise dans l’Angleterre victorienne où écrit Stevenson) et bien sûr Long John Silver qui sera ce qu’il y a de plus proche d’un père de substitution. De là, la relation entre l’enfant et le pirate est aussi ambivalente que les revirements de Silver au gré des évolutions des rapports de force et elle a un impact significatif sur les choix opérés par le héros. Si Jim prend le parti de l’ordre établi et ne rejoint pas la piraterie à la fin du récit, c’est en transgressant la règle et en désobéissant aux ordres du docteur qu’il sauve ses compagnons en coupant les amarres du navire en pleine nuit. Le contact avec les pirates et les marges qu’ils symbolisent n’est donc pas un écart de conduite mais un élément sur lequel Jim s’appuie pour se construire en tant que futur adulte. En faisant du héros de l’histoire un adolescent, La Planète au Trésor entend quant à lui s’adresser à cette classe d’âge. Que lui dit-il ? Il lui signifie que le salut est dans le respect des règles édictées par les adultes et la société. Présenté au départ comme un adolescent rétif à l’autorité causant à sa mère bien des soucis quand il se fait arrêter par la police, Jim Hawkins a vocation à rentrer dans le rang. La piraterie n’est plus un contre-modèle à intégrer dans son développement mais un moment à dépasser. Une crise d’ado en somme. D’ailleurs tout rentre dans l’ordre à la fin du film puisque Jim devient… flic, rejoignant les rangs de ceux qui l’arrêtaient et le contraignaient au début du métrage. Là où le film de Disney de 1950 s’appuyait sur les ambiguïtés morales du roman et les conflits de loyauté entre plusieurs normes antagonistes, il les laissait en suspens alors que la version de 2002 les résout en faveur du conservatisme. La Planète au Trésor ne raconte donc pas exactement la même chose que L’Île au Trésor et ça m’attriste un peu.
La Planète au Trésor reste un audacieux space opera au vu de la cohérence impressionnante entre ses enjeux thématiques, ses choix esthétiques et ses prouesses techniques. Pour un projet porté pendant 25 ans par ses créateurs et ne s’intégrant pas directement dans la ligne éditoriale Disney, il est donc d’autant plus décevant qu’il adresse aux adolescents un discours finalement rétrograde. Un simple plaidoyer pour l’esthétique de la piraterie serait néanmoins très malvenu, celle-ci recouvrant des significations bien plus diverses et contradictoires qu’il n’y paraît, permettant d’ailleurs à des gens très différents de se l’approprier (coucou la start-up nation) et il faudrait au moins y consacrer un article entier pour examiner ces aspects. Tout ça sans dire un mot sur la chanson “Un Homme Libre” de David Hallyday.