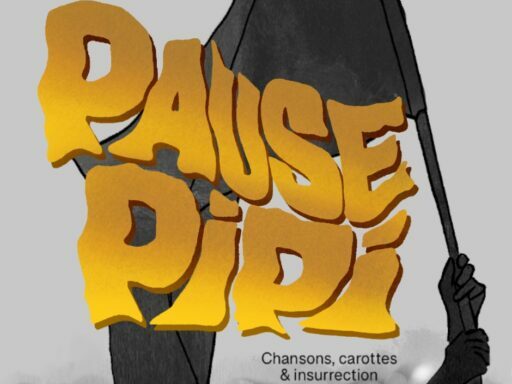Il n’y a pas grand-chose de plus triste que l’histoire de Nico. Intégrée au chausse-pied dans un groupe un peu trop légendaire, le Velvet Underground auquel son nom est accolé pour le seul disque où elle est présente, elle reste pour l’éternité figée dans un rôle de potiche immérité. “All Tomorrow’s Parties”, sa plus grande contribution au Velvet, conserve aujourd’hui encore sa majesté gothique qui doit beaucoup à l’interprétation de sa chanteuse. Puis, pour peu qu’on se penche sur son œuvre en solo, soit tout de même six disques, c’est la tristesse qui prévaut là encore, un sentiment qu’elle exprime sans ambages et un sentiment de gâchis quand on considère l’ensemble. Plus que la peur d’ailleurs, c’est bien envie de pleurer qui domine, surtout quand on relie cette musique unique à la vie de son autrice.
Ce lien entre cheminement musical et parcours personnel renforce et contrebalance à la fois la teneur dramatique voire lugubre des chansons contenues dans The Marble Index et Desertshore qui sont réédités ces jours-ci. Même s’il est toujours hasardeux voire malsain d’appréhender une œuvre à l’aune de la biographie de son auteur·ice, difficile ici de faire l’impasse sur l’itinéraire de Nico, un chemin qui semble à la fois jonché de souffrances et assumé envers et contre tout. C’est bien elle qui compose “My Only Child” sur Desertshore et “Ari’s Song” sur The Marble Index en plus de faire chanter son fils, Ari donc, sur “Le Petit Chevalier”, un fils qu’elle n’aura pas pu élever et dont la vie ressemble à un chemin de croix. Tout cela fait d’ “Ari’s Song” une des comptines les plus tristes du monde. “My Only Child” a peu d’équivalent, à part peut-être la supplique de Courtney Love qui tourne à l’adjuration sur “I Think That I Would Die”, peut-être ici aussi parce que la chanson semble faire directement écho à la vie de son autrice à qui son enfant avait été retiré.
Nico compose seule ses chansons sur son harmonium, un petit orgue portatif indien jamais tout à fait accordé qui contribue aux tonalités toujours sur le fil, un déséquilibre appuyé par la construction musicale inhabituelle où la main gauche de Nico forme les mélodies dans les graves tandis que la main droite assure des basses dans les aigus (“Janitor of Lunacy”). Là-dessus, l’ex-Velvet John Cale produit les deux disques en empilant les drones de violon alto, les cloches et les glockenspiels pour varier les textures et tessitures. Il construit de gigantesques édifices qui placent The Marble Index et Desertshore hors du monde (de la pop). Avec cette instrumentation résolument non-rock, les deux disques prennent racine dans la mémoire du romantisme européen. Si The Marble Index est un bloc anthracite, Desertshore présente des reliefs à l’ascension un peu moins ardue avec un songwriting plus accessible, à peine plus chaleureux par moments (“The Falconer”).
Comme dit plus haut, lier la musique de Nico à sa biographie n’est pas forcément la meilleure approche puisque, de son propre aveu, elle aura menti toute sa vie concernant son histoire. Un peu comme Bob Dylan, elle orchestre une perpétuelle réinvention de soi où, dans son cas, les penchants autodestructeurs auraient finalement pris le dessus. Le film Nico, 1988 de Susanna Nicchiarelli met en scène les dernières années de Nico, alors qu’elle vit sa vie d’héroïnomane à Manchester et enchaîne les tournées plus ou moins minables dans le but unique et avoué de financer ses addictions. A nouveau, c’est l’histoire racontée qui compte et donne à l’histoire son caractère épique. En mettant en scène Nico victime d’une crise de manque avant un concert à Prague sous haute tension puisque l’organisateur n’a pas demandé les autorisations nécessaires aux autorités soviétiques pour la tenue de l’évènement, le long-métrage fait prendre à l’interprétation de “My Heart is Empty” une envergure un peu sacrée rehaussée par la ferveur du public.
Le récit elliptique du film prend globalement le parti de la musicienne, tandis que le bouquin Songs They Never Play On The Radio de James Young dresse de cette dernière un portrait bien moins flatteur. Young a accompagné Nico en tant que pianiste durant la période couverte par le film et relate une existence de lose si complète qu’à partir de la page 200 de l’édition francophone les fautes se multiplient dans le texte comme si la maison d’édition avait cessé de payer pour une relecture, comme si le traducteur avait abandonné la tâche de corriger ce récit toujours plus catastrophique. James Young fait néanmoins preuve d’une forme de compréhension presqu’empathique voire de sollicitude pour la chanteuse quand il décrit son mode de vie entièrement centré sur l’addiction mais non exempt d’une forme paradoxale de détermination dans l’abandon de tout libre-arbitre. Elle est entière, fait ça « pour de vrai », et si les musiciens l’entourent ce n’est assurément pas pour l’argent vu qu’il n’y en a pas puisque, pour reprendre une citation sans doute apocryphe de John Cale à propos de l’absence de réussite commerciale de la musique de Nico, “on ne peut pas vendre le suicide“.
Pas vraiment tragique parce que quelque part dénuée de destin, l’histoire de Nico se présente comme une suite d’abandons, ce qu’elle quitte et son entourage qui la déserte. Dès la fin des années 60, elle semble vivre entourée de fantômes, comme si la vie s’était arrêtée, de sorte qu’il n’y a rien à attendre de demain. Au milieu de ce vide, elle campe une force inamovible qui ne cherche ni excuse ni justification. Sa musique a la profondeur d’un puits de mine, je comprends qu’on n’ait pas envie d’y descendre tous les matins. Mais parfois, plutôt que de chercher à lutter contre les vagues qui creusent le vide, ça me fait du bien d’accepter d’être accompagné par des gens qui parviennent à tirer quelque chose de leurs propres abysses. Et tout de suite on se sent moins seul·e.