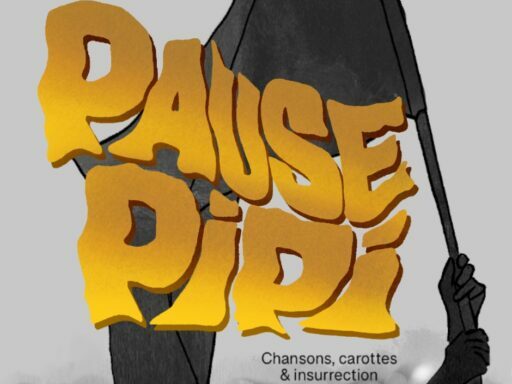Evidemment que Barbie est fait pour amener un maximum de gens en salle et vendre autant de jouets que possible. Bien sûr que je me suis fait avoir par le rouleau compresseur marketing à 100 millions de dollars visant à faire de Barbie l’un des (si ce n’est le) blockbusters de l’été, en compagnie de Mission Impossible 7 : Dead Reckoning et Oppenheimer. Mais ce n’est pas une raison pour bouder son plaisir et avoir quelques attentes vis-à-vis des produits de la pop culture, d’autant que je crois que nous sommes davantage outillé·e·s pour déceler les stratagèmes de l’industrie culturelle, les prendre en compte et apprécier les œuvres produites sans devoir sans cesse les mettre à distance critique. Et puis j’avais sans doute envie de profiter de la performance de Ryan Gosling qui n’est jamais aussi bon que dans des rôles comiques comme dans The Nice Guys (ça vaut aussi pour Brad Pitt et Georges Clooney dans Burn After Reading).
J’avais envie d’y croire à cette réconciliation sans cesse renégociée entre la pop culture et les problématiques qui traversent l’époque. Barbie est une icône comme Batman et à ce titre elle peut faire l’objet de réinterprétation au gré du temps et des évolutions sociétales. Mais j’aurais moins de mal à y croire si la mainmise de l’entreprise qui fabrique les poupées n’était pas si visible tout au long du film. Difficile d’effacer la sensation que Mattel essaie d’enfoncer dans nos gosiers son marketing mâtiné d’un storytelling qu’il estime plus adapté à l’époque pour continuer à vendre ses poupées. Quand la firme se met elle-même en scène au détour des séquences ou de répliques (“Ne t’en prends pas à moi, prends-t ‘en à Mattel, ce sont eux qui font les règles” dit Barbie Bizarre), elle brise toute la magie que le monde imaginaire de Barbieland aurait pu receler. Personne, parmi le Comité de Direction présidé par le personnage joué par Will Ferrell, ne semble surpris qu’il existe un monde dédié à Barbie hors de notre réalité, ce qui tue dans l’œuf l’irruption du surnaturel dans le réel qui aurait pu donner à Barbieland son caractère fantastique. La réalité rattrape d’ailleurs la fiction lorsqu’on sait à quel point le studio a bétonné le processus promotionnel : seuls pouvaient assister aux projections presse les critiques jugés “collaboratifs” tandis que les entretiens publiés dans la presse française ont été fournis par le distributeur. Tout va dans le sens d’un studio tellement cynique qu’il ne croit même pas à son propre film comme produit culturel pouvant faire son chemin dans le cœur du public. Barbie aurait pu être un mythe et elle se retrouve réduite à une métaphore.
Quand il s’agit d’aborder explicitement le féminisme et la place de la poupée Barbie dans la reproduction des stéréotypes de genre, le film se montre excessivement didactique (ce qui est tout de même un de ses mérites), mettant les mots exacts sur les injonctions contradictoire que le patriarcat fait peser sur les femmes via les répliques prononcées par ses personnages. Et il fait d’ailleurs comme si nommer les problèmes suffisait à les faire disparaître, comme c’est littéralement mis en scène dans une séquence où Gloria, humaine débarquée à Barbieland après la prise de pouvoir des Ken, explique à chaque Barbie en quoi elle est aliénée, ce qui provoque un réveil magique chez la Barbie concernée. Donner à la parole valeur de formule magique me séduirait tout à fait si les problèmes disparaissaient vraiment grâce à elle mais Barbie préfère briser le quatrième mur à de multiples reprises pour bien me rappeler que je regarde un film qui préfère donc s’attaquer sans cesse lui-même plutôt que se coltiner les problèmes qu’il entend dénoncer. Moi je voulais croire à ce que le film racontait mais il m’en empêche.

En déniant son pouvoir à sa fiction, le film Barbie, malgré les grands airs qu’il se donne, est en faveur d’un maintien du statu quo. Après avoir fait le constat des inégalités de genre dans le monde réel, Barbie Stéréotypée n’y remédie pas plus qu’elle n’aide Gloria et sa fille à les résoudre. Elle contribue à un retour “à la normale” à Barbieland et remet sur les épaules de chaque individu la charge de s’auto-déterminer (en enjoignant Ken “Plage” joué par Ryan Gosling à trouver seul son identité propre). Elle décide ensuite d’embrasser une forme d’humanité qui se résumera à une visite chez le gynécologue qu’on peut imaginer un préalable à la maternité plutôt qu’à la prescription d’un moyen de contraception, vu le conservatisme ambiant du film. Évidemment qu’un film sur la poupée Barbie n’a pas vocation à embrasser les thèses les plus radicales des mouvances féministes mais la prétention du film à désigner et à s’attaquer aux enjeux de son temps oblige à s’interroger sur la façon dont il s’y confronte, comme lorsque Sasha, la fille de Gloria, accuse son père d’appropriation culturelle quand il cite le “Si se puede” de l’activiste Dolores Huerta. Il n’y aura malheureusement pas de confrontation et Barbie dissout les conflictualités énoncées explicitement afin de revenir à son statut de spot publicitaire de deux heures.
Barbie passe son temps à rappeler qu’il est un film sur Barbie, s’interdisant dès lors tout ce que permet la puissance évocatrice des histoires. Le film détruit sans cesse le pouvoir de la fiction et s’empêche par ce mouvement autodestructeur d’être le film qu’il pourrait prétendre être : une appropriation de la figure de Barbie comme artefact culturel, avec son long historique ancré dans différentes époques et ses contradictions issues de cette longévité. Et avec ce personnage assumé comme tel dans toute sa puissance, Barbie pourrait raconter une véritable histoire, ce qui est d’ailleurs une des fonctions du jouet (favoriser l’imagination et la créativité). Barbie ne crée pas une histoire de Barbie où les seules limites seraient l’imagination des auteur·ice·s, en l’occurrence Greta Gerwig et Noah Baumbach, et des personnes qui regarderont le film. Le film Barbie n’est même pas à la hauteur de la place que les jouets à vendre occupent chez les enfants à qui ils sont destinés. Dans Pirates des Caraïbes, film produit par Disney pour faire la promotion d’une attraction de son parc Disneyland, les protagonistes ne sont pas des personnes jouant aux pirates dans un parc d’attraction, ils sont des pirates. A l’inverse, la narratrice de Barbie nous rappelle le statut de simple film en pointant que le choix de Margot Robbie pour jouer Barbie Stéréotypée était un choix ironiquement évident. Le film passe son temps se dire plus malin que ses spectateur·ice·s, ce qui est toujours le pire des regards à poser sur eux·elles.
Le seul instant où j’ai enfin pu me laisser emporter par l’histoire, c’est pendant le thème de Ken. La chanson “I’m Just Ken” composée par Mark Ronson et Andrew Wyatt défonce tout, Ryan Gosling déploie tout son potentiel comique en chantant les tourments existentiels de son personnage, et ça débouche sur une vraie séquence de cinéma avec une chorégraphie exécutée au premier degré par l’ensemble des Ken du film. Les paroles de la chanson suffisent largement à apporter à la scène sa dimension comique et Barbie s’autorise alors, pour un court moment, à se laisser aller à être un film de cinéma où l’histoire et ses enjeux peuvent être pris à bras-le-corps avec les outils de cet art (mise en scène, jeu, montage, etc.). On entrevoit alors ce qu’aurait pu être Barbie si le film croyait un peu plus en lui. En embrassant la force contenue par le jeu et les histoires que se racontent les êtres humains, Barbie aurait pu profiter de sa propre histoire pour mettre en scène de vraies émancipations vis-à-vis d’un réel chaque jour plus anxiogène. Le film aurait même pu décupler cette puissance en dépassant la dichotomie entre Barbieland et le monde réel pour plutôt en faire un tout interconnecté voire interdépendant (plutôt que de name-dropper le “capitalisme forcené” sans questionner le SUV que conduit Gloria).
Peut-être un jour apprendrons-nous que Greta Gerwig avait un film tout à fait différent en tête qu’elle aurait pu réaliser avec une autre équipe davantage rompue à l’exercice délicat du blockbuster, sachant qu’elle dit déjà avoir dû batailler avec Mattel pour conserver la scène pleine de tendresse partagée par Barbie Stéréotypée et une femme âgée à un arrêt de bus. Peut-on se consoler en se disant qu’au moins les bribes de discours féministes de Barbie atteindront les oreilles pas encore sensibilisées d’un public venu voir un blockbuster avec Margot Robbie et Ryan Gosling ? Vu le constat d’échec que le film dresse sur lui-même et la lutte à laquelle il prétend prendre part, il est bien optimiste de se dire qu’il pourrait faire bouger quelques lignes. Heureusement je suis un optimiste.